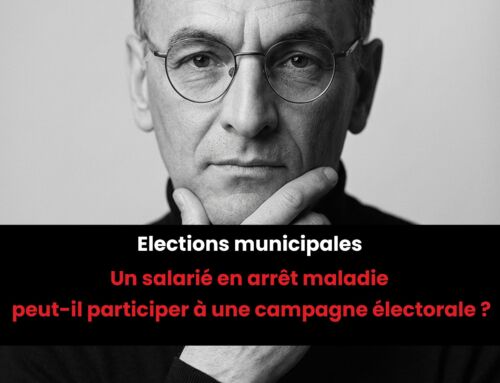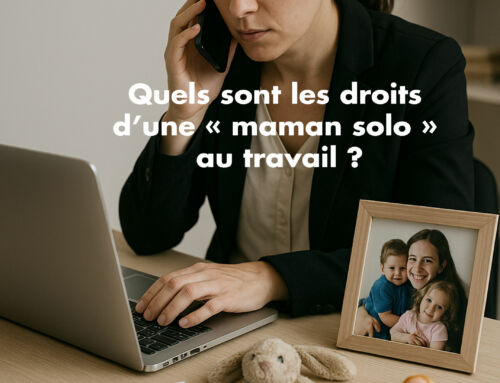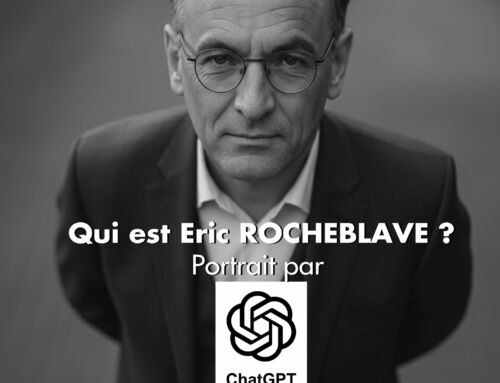10 septembre 2025 : comment “tout bloquer”… en respectant le Code du travail ?
Guide pratique par Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du travail
Le 10 septembre 2025, la France pourrait se retrouver à l'arrêt.
Derrière le mot d'ordre « Bloquons tout », un enjeu capital se cache : comment faire grève sans risquer de perdre ses droits, son emploi… ou sa crédibilité ?
Le droit de grève est l'un des piliers de notre démocratie sociale.
Mais mal exercé, il peut se retourner contre ceux qui l'invoquent : saisies de salaire disproportionnées, licenciements pour faute lourde, voire poursuites pénales en cas de débordement.
À l'inverse, lorsqu'il est utilisé avec précision, il offre une protection solide et un puissant levier de négociation collective.
Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale depuis plus de vingt-cinq ans, Eric ROCHEBLAVE a accompagné salariés, syndicats et employeurs dans les conflits sociaux les plus sensibles.
Ce guide n'est pas un simple rappel théorique : c'est un mode d'emploi concret, exhaustif et sécurisé pour comprendre ce que le Code du travail autorise… et ce qu'il interdit formellement.
Parce que le 10 septembre 2025, il ne s'agira pas seulement de « bloquer », mais de défendre ses droits sans se mettre légalement en danger.
1) Qu’est-ce qu’une grève licite en droit français ?
Une grève licite suppose :
- un arrêt total du travail,
- collectif et concerté,
- visant à soutenir des revendications professionnelles,
- portées à la connaissance de l'employeur au plus tard au début du mouvement.
À défaut, le mouvement bascule dans l'illicéité.
2) Faut-il être syndiqué ? Combien de salariés au minimum ?
Le droit de grève appartient à tout salarié, syndiqué ou non. En principe, il faut au moins deux salariés.
Exceptions : un mot d'ordre national (même un salarié isolé peut exercer le droit) ou un salarié unique dans l'entreprise.
3) Une journée nationale type « Bloquons tout » est-elle une grève politique (donc illicite) ?
Un mot d'ordre purement politique est illicite. Mais s'il est lié à des revendications sociales ou professionnelles (salaires, retraites, emploi, conditions de travail), la participation reste licite — même sans revendication interne spécifique à l'entreprise.
4) Faut-il un préavis le 10 septembre dans le secteur privé ?
Non : en droit commun du secteur privé, aucun préavis légal n'est requis.
Certaines conventions collectives peuvent prévoir un préavis, mais celui-ci n'engage que les syndicats signataires et ne s'impose pas aux salariés.
5) Et dans le secteur public et les transports ?
Le régime est différent :
- Secteur public et services publics : un préavis syndical représentatif est obligatoire, déposé 5 jours francs avant, indiquant motifs, date, heure et durée. Dans une entreprise privée chargée d'un service public, cette obligation ne concerne que le personnel affecté à ce service.
- Services publics : grèves tournantes : l'article L. 2512-3 interdit les grèves tournantes. Toutefois, la jurisprudence admet le dépôt de préavis successifs permettant d'organiser plusieurs arrêts courts et répétés.
- Transports terrestres : après négociation obligatoire, les salariés concernés doivent déposer une déclaration individuelle 48 h avant. En cas de renonciation, une information 24 h avant est exigée.
- Transport aérien : obligation de déclaration d'intention 48 h avant pour certains personnels, sans formalisme particulier.
6) Comment présenter les revendications à l’employeur ?
Elles doivent être connues de l'employeur au plus tard au moment du début de la grève.
Aucun formalisme imposé : oral, écrit, courriel, ou transmission par un tiers (inspection du travail, représentants).
Il est toutefois prudent de pouvoir prouver la communication.
7) Quelles formes de grève sont licites ?
Sont licites :
- des débrayages courts et répétés,
- des grèves tournantes dans le privé,
- des grèves « bouchons » ou partielles dans certaines unités,
dès lors qu'elles n'entraînent pas de désorganisation de l'entreprise au-delà de la simple perturbation de la production.
8) Quelles formes ne constituent pas une grève licite ?
- Grève perlée (travail au ralenti, partiel, défectueux) = exécution fautive du contrat, pas une grève.
- Grève du zèle (application tatillonne des consignes) = pas une grève.
- Autosatisfaction (les salariés s'octroient eux-mêmes ce qu'ils revendiquent, par ex. repos imposé) = prohibée.
9) Piquets, blocages, occupations : jusqu’où peut-on aller ?
- Piquets de grève : licites s'ils restent non bloquants et n'entravent pas la liberté du travail.
- Blocage des accès empêchant l'entrée des non-grévistes : illicite, constitutif de faute lourde.
- Occupations : tolérées lorsqu'elles sont symboliques et limitées, sans atteinte au droit de propriété ni risque pour la sécurité. Sinon, l'employeur peut obtenir un référé-expulsion.
10) La grève devient-elle « abusive » ?
Oui si elle entraîne une désorganisation de l'entreprise (et pas seulement une perturbation de la production) ou s'il y a une volonté manifeste de nuire.
Dans ce cas, les salariés perdent la protection attachée au droit de grève.
11) Doit-on se déclarer gréviste dans le privé ?
Non. Aucune obligation de prévenir dans le secteur privé.
Le salarié doit simplement justifier son absence par sa participation à la grève.
Dans le secteur public, avec préavis en cours, les salariés peuvent rejoindre ou quitter la grève librement pendant la période fixée. L'employeur ne peut pas déclarer la grève « terminée » faute de participants à un moment donné.
12) Quelles conséquences sur le contrat et le salaire ?
La grève entraîne la suspension du contrat de travail :
- Le salarié est dispensé de fournir sa prestation.
- L'employeur n'a pas à payer le salaire pendant la période chômée.
- La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée de l'absence (minutes/heures/jours).
- Exceptions rares (ex. pilotes en rotation de plusieurs jours).
- Aucune mention « grève » ne doit apparaître sur le bulletin de paie (cf. § 24).
- Les non-grévistes doivent être rémunérés normalement.
13) Et pour les salariés au forfait-jours qui n’ont cessé que quelques heures ?
La retenue est calculée proportionnellement :
- soit selon les modalités prévues par l'accord collectif instituant le forfait-jours,
- soit, à défaut, par conversion horaire à partir du forfait annuel.
14) Incidences sur congés payés et préavis contractuel ?
- La période de grève n'est pas assimilée à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés.
- Un préavis de rupture donné pendant la grève ne court qu'à compter de la reprise.
15) Grèves de solidarité : interne vs externe
- Interne : licite si elle poursuit un objectif collectif et professionnel (ex. défense de l'emploi, négociations annuelles obligatoires, atteinte au droit de grève).
- Externe : en principe illicite si elle vise des revendications qui ne concernent pas l'entreprise.
16) Un salarié détaché ou mis à disposition peut-il faire grève dans l’entreprise d’accueil ?
Oui, à condition que les revendications concernent directement sa situation (conditions de travail, emploi).
17) Un salarié seul peut-il faire grève le 10 septembre ?
Oui dans deux cas :
- en réponse à un mot d'ordre national,
- ou lorsqu'il est le seul salarié de l'entreprise.
Dans le secteur public, si un préavis régulier est en cours, la qualification de grève subsiste même avec un seul gréviste.
18) L’employeur peut-il imposer des règles de prévenance ou un « service minimum » dans le privé ?
Non.
L'employeur ne peut pas instaurer un délai de prévenance ou un service minimum par règlement intérieur.
Seules exceptions : dispositions légales, ou exigences de sécurité impérieuses dûment démontrées.
19) Sanctions et licenciement : que risque un gréviste ?
- Aucune sanction ni licenciement ne peut viser l'exercice normal du droit de grève.
- Seule la faute lourde, impliquant une participation personnelle à des actes illicites (blocages, violences, dégradations…), peut justifier un licenciement.
- Le licenciement est nul sans faute lourde, avec possibilité de réintégration et rappel de salaires.
- L'employeur doit viser expressément la faute lourde dans la lettre.
- Les sanctions doivent être individualisées, sans discrimination.
20) Responsabilité pénale des grévistes : quels délits possibles ?
Certains comportements en marge du droit de grève engagent la responsabilité pénale :
- Séquestration (20 ans de réclusion criminelle, peines réduites en cas de libération rapide).
- Entrave concertée à la liberté du travail (délit pénal, aggravé par violences ou dégradations).
- Vols, dégradations, violences.
21) Remplacement des grévistes : ce que l’employeur peut (ou non) faire
- Interdit : recruter des CDD ou intérimaires pour remplacer les grévistes ; augmenter le temps de travail des intérimaires déjà présents. Risques : requalification en CDI + sanctions pénales.
- Autorisé : mutations internes dans la qualification, sous-traitance ponctuelle, heures supplémentaires des non-grévistes.
- Attention : bénévolat possible, mais vigilance quant au risque de travail dissimulé.
- Interdite : toute « réquisition » par l'employeur.
22) Réquisitions par l’État (préfet) : dans quels cas ?
Le préfet peut réquisitionner certains salariés en cas d'urgence pour prévenir une atteinte grave à l'ordre public (ex. carburants, hôpitaux).
Conditions : nécessité et proportionnalité (nombre de salariés, durée). Le juge administratif exerce un contrôle strict.
23) Fermeture de l’entreprise (« lock-out ») : quand est-ce licite ?
- En principe : interdite (atteinte au droit de grève, violation de l'obligation de fournir du travail aux non-grévistes).
- Exception : lorsque l'employeur n'a aucun autre choix (danger grave pour personnes ou biens, impossibilité de diriger l'entreprise, sites Seveso).
Dans ces cas, suspension des contrats ; recours possible à l'activité partielle si la fermeture dépasse 3 jours.
24) Primes, jours fériés, RTT, congés payés : quelles incidences ?
- Salaire : retenue strictement proportionnelle ; pas de mention « grève » sur le bulletin.
- Forfait-jours : retenue proportionnelle ; si un accord collectif interdit les retenues < demi-journée, il s'applique.
- Jours fériés inclus : non payés aux grévistes.
- Primes : réduction possible si toutes les absences sont traitées de façon identique ; sinon, discrimination.
- Prime “anti-grève” interdite ; une prime de surcroît de travail aux non-grévistes est licite si objectivement justifiée.
- RTT / congés : jours de grève non assimilés à du travail effectif → pas d'acquisition de droits, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, appliquées sans discrimination.
- Préavis de rupture : non prolongé par la grève ; s'il est notifié pendant la grève, il commence à courir à la reprise.
25) Mandats des représentants (CSE, délégués) et heures de délégation
- Le mandat n'est pas suspendu par la grève.
- Les élus peuvent circuler dans l'entreprise pour leurs missions, sauf abus.
- Les heures de délégation sont rémunérées, même si elles sont prises pendant une grève.
- Les réunions obligatoires du CSE doivent être tenues : la grève ne constitue pas un cas de force majeure permettant de les reporter.
26) Élections professionnelles organisées pendant un conflit : validité ?
Les élections restent régulières si la grève ne prive pas la majorité des salariés de leur possibilité de voter. L'appréciation est au cas par cas (présence, accès, information).
A lire également :
Quand une grève est-elle abusive ?
Peut-on être licencié pour avoir incité ses collègues à faire grève ?
La grève dans les transports en commun est-elle une excuse pour être en retard ou absent au travail ?
Les coupures d’électricité sont-elles des actes illicites de grève ?
Un employeur peut-il verser une prime aux seuls salariés non-grévistes ?
Le déblocage des raffineries peut être illégal… pas leur blocage !
Un salarié malade peut-il être gréviste ? Un gréviste peut-il être malade ? Un salarié malade peut-il manifester ?
Eric ROCHEBLAVE - Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D'UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Lauréat de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d'Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d'Informatique Juridique
Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE