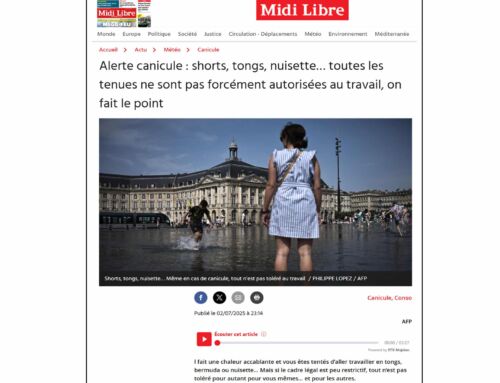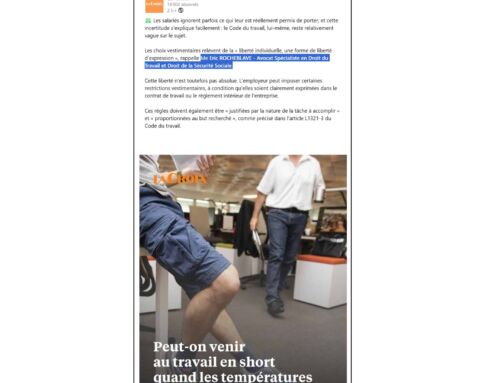La Société Générale condamnée pour harcèlement moral
Succès judiciaire de Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale au Barreau de Montpellier à faire juger par le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Montpellier :
Conseil de Prud'hommes de Montpellier, jugement de départage du 11 février 2020 RG N° F 15/01604
- « que M. G. a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur la Société Générale
Ce harcèlement s'est poursuivi pendant plusieurs années et c'est la destruction professionnelle et personnelle du salarié qui était en jeu, avec des risques pour sa vie mentionnés par les soignants et concrétisés par une tentative de suicide sur son lieu de travail.
A travers la négation de son travail puis la négation de sa personne elle-même, pas seulement en tant que salarié mais en tant qu'être humain sensible, digne de respect et de considération, il a eu sur sa santé, sa vie de famille, sa vie professionnelle, son regard sur lui-même et les autres, des conséquences d'une gravité certaine, justifiant une indemnisation par des dommages et intérêts qui seront forfaitairement évalués à la somme de 10.000 euros. »
- « qu'après analyse des pièces produites, le Conseil a conclu à l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de M. G
Cette analyse a également permis de constater que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve en matière d'obligation de sécurité, ne rapporte pas la preuve qu'il ait tenté de soustraire M. G. à la situation de harcèlement moral dont il était victime de la part de sa hiérarchie directe ou qu'il aurait mis en œuvre des moyens pour le protéger et assurer ainsi ses devoirs contractuels de sécurité.
Au contraire, la mise en œuvre d'un plan de prévention en septembre 2015 alors que la situation est problématique depuis janvier 2014 est tardive.
La décision de mettre le salarié sous l'autorité hiérarchique directe d'un supérieur, M. D., avec lequel il est également en conflit depuis janvier 2014, en ce qu'appelé à l'aide celui-ci non seulement n'est pas intervenu en sa faveur mais a participé au litige contre lui, ne garantit au salarié aucun protection.
Les agissements destinés à taire les difficultés ne représentent pas une protection du salarié : pressions sur la DEC de Perpignan, lettre de remarque à Mme D., refus de faire les déclarations d'accident du travail, mise en demeure de la DIRECCTE, contestation de la situation psychique du salarié ...
Une enquête menée par le service mis en cause n'offre pas de garantie d'objectivité.
Une enquête concluant au maintien de la situation causant pourtant depuis plusieurs années des arrêts maladie des deux protagonistes pour RPS n'est pas de nature à garantir au salarié une protection de sa santé psychique et physique.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le manquement de la société employeur à son obligation de moyen renforcée pour assurer la sécurité de son salarié est patent.
Il s'agit d'une faute grave qui a occasionné au demandeur un préjudice certain : préjudice physique et moral, préjudice également financier.
M. G. a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, il a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail, a dû mettre en place un suivi psychologique et psychiatrique pendant plusieurs années.
Son préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être totalement réparé, par des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros nets. »
- La nullité du licenciement et la condamnation de la Société Générale à verser la somme de 35.000 euros nets à titre de dommages et intérêts
- L'exécution provisoire de la décision
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, constituent des faits de harcèlement moral d'un salarié les agissements répétés qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Peuvent notamment caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par ce type d'agissements. Par ailleurs, l'intention de nuire n'est pas nécessairement un élément constitutif.
En terme de charge de la preuve, l'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit simplement des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; ensuite, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge donne sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Montpellier a jugé que :
« Monsieur G. soutient qu'il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, établissant des faits précis et concordants, tandis que son ancien employeur ne parvient pas à démontrer que ces faits sont étrangers à tout harcèlement moral et se justifient par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il indique qu'il a été embauché dans un contexte de souffrance au travail de son prédécesseur dont la même hiérarchie était responsable.
Il a été accusé à tort par sa supérieure hiérarchique directe d'avoir créé un conflit lors d'un Comité d'entreprise, étant ensuite victime de mails infantilisants sur le sujet.
Lorsqu'il en a informé le superviseur RH, celui-ci s'est montré agressif à son encontre et a refusé d'intervenir.
Il a été placardisé : suppression du partage du planning, retard de validation de ses feuilles de frais, absences de sa supérieure injoignable pour lui, absence de réponse à ses mails et appels téléphoniques.
Il a subi une sanction pécuniaire prohibée avec la réduction injustifiée de sa part variable.
Il indique que le problème n'était pas uniquement causé par sa supérieure hiérarchique directe, Mme D., mais relevait de l'organisation du service social.
En raison de ces agissements répétés, son état de santé s'est dégradé et il a déclaré deux accidents du travail de type RPS reconnus par l'assurance maladie.
La situation a également conduit l'Inspection du travail à intervenir en sa faveur.
De son côté, la SA SOCIETE GENERALE soutient que M. G. n'a pas été victime de faits de harcèlement moral, au vu de l'enquête interne menée en suite de ses dénonciations. Il a confondu cette notion avec le pouvoir de contrôle et de direction de sa responsable hiérarchique et l'existence éventuelle de difficultés relationnelles.
La défenderesse ne conteste pas que d'autres avant lui aient fait état de situation de harcèlement moral au sein du service social de Marseille mais il a été recruté avant ces accusations officielles.
Elle confirme le fait que M. G. a créé un conflit lors d'une réunion du Comité d'entreprise en janvier 2014, conteste la mise en cause de M. G. par Mme D. lors d'une réunion mensuelle au premier trimestre 2014, réfute toute placardisation et note qu'ayant diligenté une enquête, il ne peut lui être reproché son inaction. M. G. a refusé de participer à cette enquête.
La diminution de la part variable en 2014 correspond à la diminution d'une prime discrétionnaire qui n'est garantie ni dans son principe ni dans son montant. Il en est de même pour 2015.
Les attestations et certificats médicaux qui n'émanent pas de la médecine du travail ne sont pas recevables.
Les accidents du travail sont contestés. La CPAM ne les a pas tous reconnus. Le TASS a invalidé la reconnaissance des faits du 25 juin 2015 comme accident du travail.
A titre liminaire, le Conseil observe que le Conseil des Prud'hommes de Montpellier en sa formation paritaire a déjà jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. G. était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La formation de départage du Conseil n'a pas à revenir sur des points déjà jugés et n'a donc pas à analyser les pièces et moyens relatifs à des critiques émises à l'encontre de M. G. sur son travail, mais seulement à vérifier l'existence de faits de harcèlement moral.
Dans ce cadre, il constate que M. G. n'a eu au cours de l'exécution de son contrat de travail avec la défenderesse aucune sanction disciplinaire ni rappel à l'ordre de quelle nature que ce soit.
Pendant 6 ans, il a effectué son travail sans faire part de difficulté et sans que son employeur ne lui fasse un reproche, tant sur la qualité de son travail que sur son comportement.
Ses évaluations professionnelles avant 2013 sont très bonnes et les nombreux mails qu'il produit très positifs quant à son action, tandis que son employeur le rend ce jour responsable des tensions.
Parallèlement à ce constat, le Conseil observe que la direction régionale de Marseille a déjà connu des tensions et différends similaires, en 2006, 2008 et 2010, avec des arrêts maladie de longue durée pour harcèlement moral au travail subi par Mme G. puis Mme M., prédécesseurs de M. G., ce que ne conteste pas la défenderesse.
Le prédécesseur de Mme D., Mme B., assistance sociale régionale à Marseille, a de son côté quitté son poste suite à un rapport de l'ensemble des assistants sociaux de l'équipe régionale la mettant en cause pour des faits de harcèlement moral.
A la lecture des pièces du dossier, le premier point déterminant de crispation entre Mme D. et M. G. a trait à un mail de Mme D. adressé à M. G. le 14 janvier 2014, faisant
état d'un avis commun avec le superviseur RH de Marseille M. D. accusant M. G. de « jouer au pompier pyromane avec les organisations syndicales » et concluant « que ceci ne se reproduise plus à l'avenir! » quant à un incident qu'il aurait créé lors d'un Comité d'entreprise à Perpignan.
A titre de justification sur la réalité de cet incident, la défenderesse produit un mail de Mme Q. en date du 6 janvier 2014, lequel a suffi à lui seul à provoquer un rappel à l'ordre de M. G. par sa hiérarchie, sans aucune vérification et sans même avoir auparavant entendu le principal intéressé.
M. G. de son côté à l'époque s'est rapproché de manière ouverte des dirigeants de la DEC (Direction d'Exploitation Commerciale) de Perpignan pour vérifier si une mauvaise réflexion avait pu lui échapper, a reçu confirmation de l'absence d'incident créé par lui et a donc contesté le grief fait.
Sa contestation s'est doublée de deux mails des 21 et 23 janvier 2014 et d'un appel téléphonique des Directeurs de la DEC de Perpignan, du RRHL de Perpignan et du DRH de Perpignan pour confiner que M. G. n'avait créé aucun incident et qu'il donnait toute satisfaction.
Pour autant, M. G. n'a pas reçu d'excuse de sa supérieure hiérarchique ni de M. D., lesquels ont continué à l'accuser à tort.
Par mail, M. D. lui a même reproché le fait que les dirigeants de la DEC de Perpignan aient pu témoigner en sa faveur à sa demande, alors qu'il s'agit de l'exercice normal des droits de la défense de tout salarié.
Loin de s'excuser et de reconnaître l'erreur commise, sa hiérarchie a ainsi tenté d'empêcher la mise à jour du caractère fallacieux de l'accusation par des pressions sur M. G. et sur la DEC de Perpignan, démontrant ainsi sa mauvaise foi.
Dans le cadre du présent litige, M. G. produit des mails et attestations de la DEC de Perpignan de l'époque venant confirmer que ces accusations avaient été faites à tort et que plusieurs responsables de Perpignan étaient intervenus pour les faire cesser, en vain.
M. G. donc en effet été victime de reproches tenant à des faits imaginaires.
Ces reproches injustifiés ne sauraient correspondre à l'exercice du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction d'un salarié qui n'implique pas l'arbitraire et l'absence de précaution.
Les échanges de mail produits démontrent les difficultés sérieuses entre M. G. et sa hiérarchie dès cette époque, par exemple un mail du 11 mars 2014 de M. D. à M. G. affirmant que l'échange de la veille avec Mme DR n'était pas serein.
Il s'en est suivi une baisse de la part variable de la rémunération de M. G. en mars 2014, laquelle n'est pas contesté en défense.
La chronologie rapproche cette baisse de rémunération des fausses accusations de janvier 2014.
S'agissant d'un élément matériel pouvant correspondre à du harcèlement moral, il ne suffit pas à la défenderesse de répondre qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait car cet élément de rémunération est discrétionnaire. Il convenait de démontrer en quoi cette décision était justifiée objectivement et étrangère à tout harcèlement moral. Or elle ne le fait pas.
Aucune explication n'est donnée de cette baisse soudaine de rémunération en 2014, maintenue en 2015, alors que les sanctions pécuniaires sont en effet interdites, de même que les mesures de rétorsion contre un salarié se plaignant de faits de harcèlement moral.
A l'époque M. G. avait demandé des explications, en vain.
Elles ne sont toujours pas apportées au jour de l'audience.
M. G. a donc en effet fait l'objet de restrictions inexpliquées pendant deux ans sur sa partie variable de rémunération.
L'avocat de M. G. a écrit à plusieurs reprises que le 10 juin 2014, dans ce contexte-là, il a attiré l'attention du siège de la SA SOCIETE GENERALE à Puteaux quant à des faits de harcèlement moral subis par son client, singulièrement de la part de Mme D.
Cela est contesté par la défenderesse et il n'y a au dossier pas de preuve d'envoi de ce courrier.
Cependant, il est reconnu par la défenderesse que M. G. a lu ce courrier à Mme D., ce qui implique d'une part qu'il existe, d'autre part que Mme D. a été avisée du fait que M. G. se plaignait de subir des faits de harcèlement moral de sa part dès le printemps 2014.
M. démontre également par la production de plusieurs échanges de mails qu'à compter de septembre 2014, Mme D. a empêché l'accès à son planning et était injoignable, par mail et sur son portable, alors qu'il avait besoin de la contacter concernant plusieurs dossiers.
Lorsque la défenderesse indique que c'était le cas pour toute l'équipe, il apparaît dans des échanges entre Mme D. et sa hiérarchie que cette absence de réponse à certains mails de M. G. correspondait à une stratégie concertée avec la direction, par exemple :
« Pour votre info. Mail auquel je pense ne pas devoir répondre, comme convenu avec vous. Dominique ».
Ces agissements ne sauraient correspondre à l'exercice du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction d'un salarié.
Parmi les autres griefs faits par M. G. figure le retard de paiement de ses notes de frais en janvier 2015, lequel est reconnu par la défenderesse, qui y voit un incident mineur et isolé, ce qui serait pertinent s'il ne prenait place dans une série d'agissements débutés en janvier 2014.
La situation ne s'améliorant pas, M. G. va être reçu en entretien le 25 juin 2015 par Messieurs M. et R., DRH.
A la suite de cet entretien, M. G. s'est rendu chez son médecin traitant qui a constaté chez son patient un état d 'hyper stress avec crise de larmes et impossibilité de s'exprimer, termes qui ont été repris par Mme D., assistante RH à Montpellier, dans la déclaration d ' accident du travail qu'elle va dresser concernant M. G.
Est produit au dossier un courrier d'avertissement qualifié de « lettre de remarque » adressé par la hiérarchie de M. G. à cette assistante RH pour lui reprocher d'avoir saisi sur le serveur de la CPAM la déclaration d'accident du travail.
Cette lettre de remarque est problématique au regard de la présomption d'accident du travail pour tout incident de santé dans le cadre professionnel. L'employeur doit faire une déclaration du travail, même s'il lui est loisible ensuite de l'accompagner de réserves.
Il n'est pas légitime à faire pression sur une salariée ni la sanctionner pour avoir effectué une déclaration d'accident du travail correspondant aux éléments médicaux présentés.
Ces agissements ne sauraient correspondre à l'exercice du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction d'un salarié.
M. G a ainsi été placé en arrêt de travail du 30 juin au 30 septembre 2015 pour un accident du travail de type RPS en date du 25 juin 2015, reconnu comme tel par la CPAM.
Le 20 juillet 2015, M. G. s'est plaint de subir une situation de harcèlement moral dans un mail à sa hiérarchie, et son avocat dans un courrier au directeur de la CPAM de l 'Hérault, comme le signale la défenderesse.
Dans ce contexte-là et alors que la hiérarchie de M. G. avait été avisée au plus tard dès le printemps 2014 de ses accusations de harcèlement moral, il est difficilement compréhensible qu'elle affirme tomber des nues en recevant le courrier de l'avocat de M. G. en date du 27 août 2015, par lequel cet avocat écrit informer de nouveau l'employeur de M. G. d'une situation de harcèlement moral subi par lui de la part de sa supérieure hiérarchique directe, Mme D.
En réponse, les 15 et 18 septembre 2015, la SA SOCIETE GENERALE a avisé M. G. et son avocat de la mise en place immédiate de la procédure de prévention du harcèlement moral et du détachement hiérarchique temporaire de M. G. auprès de M. D.
M. G. n'a pas souhaité participer à cette procédure, notant qu'il ne s'agissait plus de prévention et que les faits de harcèlement moral subis relevaient non d'une seule personne en particulier mais de l'organisation du service social.
Il a continué cet avis par écrits des 28 septembre, 2 octobre et 3 novembre 2015.
Par courrier du 3 décembre 2015, l 'employeur a conclu que M. G. n'avait pas été victime de harcèlement moral, précisant qu'il diligentait tout de même une enquête. Il est particulièrement curieux de donner les conclusions d'une enquête avant sa mise en œuvre et cette conclusion préalable fait fortement douter de l'objectivité de l'enquête diligentée.
Cette enquête a été menée sans M. G., par la RH de Marseille.
Elle a consisté à entendre deux assistantes sociales de l'équipe de Mme D et une de ses collègues assistante sociale régionale.
Elle a conclu le 2 février 2016 que c'était M. G. lui-même qui était responsable du climat tendu de son environnement professionnel et qu'il n'y avait donc aucune raison de ne pas le rattacher de nouveau hiérarchiquement à Mme D.
Lors de la réunion exceptionnelle du CHSCT du 29 mars 2016, l'Inspection du Travail s'est étonnée que cette enquête ait été menée par la RH de Marseille alors que M. G. était rattaché à la DEC de Montpellier et que c'était au CHSCT de la DEC de Montpellier de la mener.
Il est exact là encore qu'on peut s'interroger sur l'objectivité d'une enquête menée par la RH de Marseille sur le fonctionnement de la RH de Marseille accusée d'être à l'origine de harcèlement moral.
On peut s'interroger également sur les conclusions de cette enquête : l'équipe de la Direction régionale de Marseille ne voulait plus travailler avec M. G., tout comme elle n'avait plus voulu travailler avec Mme M. et avec Mme B. ; les pièces produites sont claires sur le fait que plus personne n'adressait même la parole à M. G.; Mme D. avait elle-même été placée en arrêt maladie. Malgré tout cela, les conclusions de l'enquête sont qu'il n'y a aucune raison de ne pas rattacher de nouveau hiérarchiquement M. G. à Mme D., laissant ainsi tous les antagonistes dans la même situation.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la situation a continué à se dégrader et l'employeur de M. G. lui a adressé un courrier le 10 mars 2016 le convoquant à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 mars 2016.
Par ce courrier, M. G ne faisait pas l'objet d'une mise à pied conservatoire ni disciplinaire mais d'une simple dispense d'activité de sorte qu'il avait la possibilité de se rendre ou non sur son lieu de travail.
Pourtant, lorsqu'il s'est présenté à son travail le lundi 14 mars 2016, Il a constaté que tout accès au système informatique lui était refusé et qu'il ne pouvait donc effectuer sa prestation de travail, ses habilitations ayant été coupées.
Il s'en est inquiété et après un contact de son avocat avec l'employeur, M. D lui a écrit par mail du 15 mars 2016 qu'il pouvait se présenter s'il le souhaitait sur son lieu de travail pour continuer son travail et qu'il n'était pas question de s'y opposer.
Pourtant les difficultés ont perduré : le mardi 15 mars 2016, lorsqu'il s'est présenté sur son lieu de travail, il n'a pas pu entrer, il a donc sonné et personne n'a voulu lui ouvrir la porte. Puis en définitive, on l'a fait entrer, on lui a demandé ce qu'il faisait là, enfin on l'a laissé dans un bureau sans qu'il puisse travailler, avec accès refusé au système informatique.
C'est à ce moment-là que M. G. a fait une tentative de suicide par prise médicamenteuse sur son lieu de travail. Il a été pris en charge par les pompiers.
Il est exact qu'il n'était pas légal d'empêcher M. G de travailler alors qu'il n'était pas mis à pied et encore moins licencié.
Ces agissements ne sauraient correspondre à l'exercice normal du pouvoir de direction, de contrôle et de sanction d'un salarié.
Si elle a donné lieu à un arrêt de travail, cette tentative de suicide sur le lieu de travail n'a pas conduit l'employeur à faire une déclaration d'accident du travail ni à donner des suites idoines à cet évènement d'une gravité certaine.
C'est donc l'inspection du travail qui a dû mettre en demeure l'employeur par un courrier du 18 mars 2016 de transmettre la déclaration d'accident du travail, de provoquer un CHSCT exceptionnel compte tenu de l'accident du travail avec arrêt du 15 mars 2016, de faire une enquête conformément aux articles L 4612-5 et R 4612-2 du code du travail, et de faire une mise à jour de la DUREP conformément à l'article R 4121-3 du code du travail.
Elle lui a donné 15 jours pour indiquer les suites données aux observations faites.
Elle lui a rappelé également que la prévention des risques psycho-sociaux faisait partie intégrante de la politique de préventions des risques professionnels et quel' employeur al' obligation de prendre des mesures de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés en vertu de l'article L 4121-1 du code du travail.
Elle a souligné que la tentative de suicide par prise médicamenteuse sur le lieu de travail par M. G. devait conduire à des mesures de prévention pour éviter tout renouvellement.
Au vu des éléments du dossier, l'employeur a contesté l'accident du travail, puis au retour de M. G. l'a convoqué à nouveau à un entretien préalable et l'a licencié pour insuffisance professionnelle le 13 janvier 2017.
Il s'évince de l'ensemble la démonstration de l'existence d'une série d'évènements et de prises de décision au détriment de M. G. permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et non justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le plan médical, il n'apparaît pas que M. G. rencontrait des difficultés d'ordre psychique avant ces évènements. Il n'est pas contestable qu'à compter de 2014 son état de santé s'est fortement dégradé, allant jusqu'à la mise enjeu de sa vie même.
Sa mère et sa sœur ont écrit le 6 septembre 2016 au directeur de la société employeur pour décrire l'effondrement physique et psychique de M. G., leur inquiétude à son sujet alors que sa vie personnelle avec son épouse et ses trois enfants restait stable et équilibrée, déplorant que ses conditions de travail l'aient conduit à tenter de se suicider sur son lieu de travail.
Elles dénoncent dans ce courrier un harcèlement moral incompréhensible pour cet homme qui a toujours été très apprécié dans son travail et demandent qu'il cesse.
Au-delà de ces constats familiaux, M. G. a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie pour état anxio-dépressif en lien avec le travail.
Dès le 30 juin 2015, le médecin de M. G. note avec pertinence dans son arrêt de travail pour accident du travail : « DANGER PSYCHIQUE ++++ » après avoir mentionné « pleurs et effondrement psychique, insomnie, incapacité de travail, lors d'un entretien avec 2 Directeurs relatifs à des suites d'entretien individuel et réception d'une conclusion de PDP ».
La CPAM le 7 septembre 2015 a reconnu que cet entretien du 25 juin 2015 était la cause d'un accident du travail. Le Médecin Conseil a confirmé cela le 23 septembre 2015.
Si l'état de M. G. a été considéré comme consolidé le 30 septembre 2015, la persistance des troubles est relevée le 25 juin 2016.
La Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de contestation présentée par l'employeur par décision du 15 décembre 2015.
La défenderesse a donc saisi le TASS qui, le 13 novembre 2017, a dit la décision de la CPAM inopposable à l'employeur.
Dans une attestation du 23 octobre 2015, Mme B., psychologue du travail, indique suivre M. G et décrit les symptômes graves qu'elle constate chez lui telles qu'insomnies de maintien, cauchemars à répétition, sentiment de baisse d'estime de soi, dévalorisation, isolement, difficultés émotionnelles.
Le 15 avril 2016, le centre de consultations des pathologies professionnelles du CHRU de Montpellier mentionne dans un compte rendu de consultation de la main du Dr L., médecin du travail, le changement dans la situation de M. G. en août 2013 suite à un changement de direction régionale des ressources humaines donnant plus de latitude à l'assistante sociale coordinatrice de la région, en l'occurrence Mme D.
Sur le plan médical, il précise que M. G. a effectivement été victime d'un accident du travail reconnu comme tel par la CP AM le 25 juin 2015, puis reconnu au titre des maladies professionnelles.
Il fait état de sa tentative de suicide sur son lieu de travail et de sa prise en charge dans ce cadre par le service des urgences du CHRU de Montpellier puis le service post urgence psychiatrique du CHRU de Montpellier.
Le médecin du travail décrit les troubles constatés, confirme la nécessité d'une poursuite du suivi par la psychologue du travail et du suivi par son service en consultation de souffrance au travail.
Ce suivi s'est en effet poursuivi, selon un compte rendu du 27 juin 2016 du même médecin du travail, constatant un syndrome dépressif important et l'impossibilité d'un retour dans l'entreprise.
Le médecin traitant de M. G. confirme dans un certificat médical du 1er juillet 2016 !'aggravation de !'état de santé de son patient en suite de l'accident du travail reconnu comme tel en juin 2015 puis d'une tentative de suicide sur le lieu de travail, dans la continuité de cet accident du travail de juin 2015, l'aggravation de son état psychique justifiant un suivi rapproché et la reconnaissance d'une maladie professionnelle.
Le 15 septembre 2016, ce médecin atteste une nouvelle fois des constats faits quant à l'état psychique de son patient, avec d 'impo1iantes difficultés cognitives depuis le 15 mars 2016.
Dans une attestation du 1er septembre 2016, Mme L., psychologue clinicienne, certifie avoir reçu M. G. pour un suivi psychologique suite à un harcèlement au travail, décrit les symptômes post-traumatiques très nombreux qu'elle a pu relever et indique que l'état du patient nécessite une prise en charge régulière pour retrouver une vie adaptée « malgré le traumatisme avéré ».
Lorsque la défenderesse soutient que tous ces éléments médicaux doivent être considérés comme non probants quant à l'existence d'un harcèlement moral, elle méconnaît plusieurs réalités :
-Contrairement à ce qu'elle avance, M. G. n'a pas été déclaré apte par la médecine du travail jusqu'à son licenciement : le 30 juin 2015 il a rencontré le médecin du travail qui n'a pas rendu d'avis pour la raison sui vante : « nécessité d'un arrêt maladie et d'une prise en charge thérapeutique » « à revoir en mars 2016 ».
-M. G. a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail.
Les assertions selon lesquelles ce n'est pas une tentative de suicide car il n'est pas décédé et n'est resté que 24 heures hospitalisé ne sauraient retenir l'attention du Conseil.
Il en est de même du courrier du 20 décembre 2016 de la DRH Mme B. affirmant à la CPAM qu'il n'est pas prouvé que M. G. ait fait une tentative de suicide sur son lieu de travail, alors que cela est acquis aux débats et que les pompiers sont venus le
prendre en charge sur son lieu de travail, comme cela ressort du compte rendu de la réunion exceptionnelle du CHSCT du 29 mars 2016 et de l'ensemble des pièces médicales du dossier.
Il en est également de même du compte rendu du directeur de la DEC de Montpellier affirmant que ce salarié n'avait « manifesté aucun comportement laissant supposer une fragilité psychologique » et que le médecin du travail n'avait « jamais relevé l'existence d'état psychologique qui aurait pu nécessiter un suivi et une attention particulière », contraire aux pièces du dossier.
-Les soignants ayant eu à connaître M. G. sont en pleine capacité de décrire l'altération de son état de santé et en tant que professionnels de santé sont également pleinement compétents pour analyser la bonne adéquation entre ses plaintes lors de l 'interrogatoire qu'ils font et les conséquences médicales constatées.
Il n'est guère nécessaire d'être médecin du travail pour conclure qu'une tentative de suicide sur le lieu de travail après plusieurs aimées de dénonciation d'une situation de harcèlement moral constitue une altération de l'état de santé psychique et physique cl' un patient, en lien avec les conditions de travail.
Le lien entre la dégradation de l'état de santé de M. G. et ses conditions de travail ne fait aucun doute.
De fait, est démontrée l'existence d'un faisceau d'évènements concordants, d'une dégradation consécutive de l'état de santé de M. G., d'une information renouvelée de l'employeur sur la gravité de la situation par le salarié, son avocat, sa famille, les soignants, l'Inspection du travail.
M. G. produit ainsi des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent au moins présumer et de fait établissent que les agissements répétitifs de l'employeur au cours des dernières années de relation contractuelle sont constitutifs de violences morales et psychologiques graves qui sont à l'origine de la dégradation démontrée de son état de santé et d'une évolution de carrière stoppée.
L'employeur, à qui il incombait alors d'établir que ces agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, n'en rapporte pas la preuve.
L'intention de nuire n'a quoi qu'il n'en soit pas à être démontrée, le harcèlement moral ne visant pas seulement les agissements ayant eu pour objet, mais aussi pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par conséquent, il y a lieu de dire que M. G. a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur.
Ce harcèlement s'est poursuivi pendant plusieurs années et c'est la destruction professionnelle et personnelle du salarié qui était en jeu, avec des risques pour sa vie mentionnés par les soignants et concrétisés par une tentative de suicide sur son lieu de travail.
A travers la négation de son travail puis la négation de sa personne elle-même, pas seulement en tant que salarié mais en tant qu'être humain sensible, digne de respect et de considération, il a eu sur sa santé, sa vie de famille, sa vie professionnelle, son regard sur lui-même et les autres, des conséquences d'une gravité certaine, justifiant une indemnisation par des dommages et intérêts qui seront forfaitairement évalués à la somme de 10.000 euros.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du Travail, l'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il s'agit d'une obligation de sécurité qui couvre notamment les problèmes de stress au travail, le volume de travail imposé au salarié, la réorganisation de son travail, les violences physiques et morales exercées contre lui par un autre salarié, dans la mesure où ils présentent un risque pour la santé et la sécurité ou ont participé de façon déterminante aux problèmes de santé de ce salarié.
Seul l'employeur qui établit avoir pris toutes les mesures idoines prévues par les articles L 4121-1 et -2 du code du travail pour remplir son devoir de sécurité vis-à-vis d'un salarié ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant d'assurer cette sécurité et de protéger la santé mentale et physique de ses salariés.
L'article L 4624-1 du même code fixe en outre des dispositions particulières, obligeant l'employeur à prendre en compte les préconisations du médecin du travail selon des considérations liées à l'âge, la résistance physique ou l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Le non-respect par l'employeur de ces obligations relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés est de nature à leur causer un préjudice particulier, distinct de celui résultant d'un accident du travail qui ressort de la compétence du Tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l'espèce, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Montpellier a jugé que :
« M. G. soutient que son employeur, outre un harcèlement moral, a commis des violations à son obligation de sécurité.
En effet, informé de ces agissements, la SA SOCIETE GENERALE n'a pas pris de mesures immédiates propres à les faire cesser, et avant le signalement de ces agissements, n'a pas pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et -2 du code du travail.
Elle n'a pas non plus mis en œuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral. Elle a donc également violé son obligation de sécurité.
De son côté, la défenderesse affirme que la société a tout mis en œuvre pour respecter son obligation de sécurité, prenant des mesures de prévention et les mettant en œuvre, réalisant des actions de formation et d'information propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral et prenant les mesures nécessaires de manière à faire cesser les agissements dénoncés.
Après analyse des pièces produites, le Conseil a conclu à l'existence de faits de harcèlement moral à l'encontre de M. G
Cette analyse a également permis de constater que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve en matière d'obligation de sécurité, ne rapporte pas la preuve qu'il ait tenté de soustraire M. G. à la situation de harcèlement moral dont il était victime de la part de sa hiérarchie directe ou qu'il aurait mis en œuvre des moyens pour le protéger et assurer ainsi ses devoirs contractuels de sécurité.
Au contraire, la mise en œuvre d'un plan de prévention en septembre 2015 alors que la situation est problématique depuis janvier 2014 est tardive.
La décision de mettre le salarié sous l'autorité hiérarchique directe d'un supérieur, M. D., avec lequel il est également en conflit depuis janvier 2014, en ce qu'appelé à l'aide celui-ci non seulement n'est pas intervenu en sa faveur mais a participé au litige contre lui, ne garantit au salarié aucun protection.
Les agissements destinés à taire les difficultés ne représentent pas une protection du salarié : pressions sur la DEC de Perpignan, lettre de remarque à Mme D., refus de faire les déclarations d'accident du travail, mise en demeure de la DIRECCTE, contestation de la situation psychique du salarié ...
Une enquête menée par le service mis en cause n'offre pas de garantie d'objectivité.
Une enquête concluant au maintien de la situation causant pourtant depuis plusieurs années des arrêts maladie des deux protagonistes pour RPS n'est pas de nature à garantir au salarié une protection de sa santé psychique et physique.
Par conséquent, il y a lieu de dire que le manquement de la société employeur à son obligation de moyen renforcée pour assurer la sécurité de son salarié est patent.
Il s'agit d'une faute grave qui a occasionné au demandeur un préjudice certain : préjudice physique et moral, préjudice également financier.
M. G. a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, il a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail, a dû mettre en place un suivi psychologique et psychiatrique pendant plusieurs années.
Son préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être totalement réparé, par des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros nets.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse, de sorte que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; les motifs avancés doivent être réels, précis, matériellement vérifiables, sans quoi cela équivaut à une absence de motif, et suffisamment importants pour justifier une rupture du contrat de travail.
L'article L 1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère sérieux et réel des motifs invoqués par l'employeur, fonde sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l'article L 1152-3 du code du travail, tout licenciement opéré en violation de cet article est nul et emporte pour le salarié un droit à réintégration.
En l'espèce, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Montpellier a jugé que :
« M. G. affirme que le harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur a dégradé ses conditions de travail et détérioré son état de santé, au point qu'il a été placé en arrêt maladie puis licencié sous des motifs fallacieux.
Ce sont donc bien les manquements de l 'employeur qui sont la cause de son licenciement, de sorte que celui-ci est nul.
Selon la défenderesse, faute de harcèlement moral, le licenciement de M. G. ne saurait être nul.
Le Conseil a retenu le harcèlement moral et constaté ses conséquences sur le plan de la santé et de l'évolution professionnelle de M. G..
Son licenciement s'inscrit dans le contexte du harcèlement moral imputable à l'employeur. Il est donc nul.
Si le licenciement d'un salarié est nul, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et en cas de refus, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du code du travail.
Selon la défenderesse, M. G. ne justifie pas de son préjudice dans les proportions des sommes sollicitées.
Au cas d'espèce, M. G. a été arrêté plusieurs mois pour raisons de santé, il a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail, il a été hospitalisé et suivi en psychiatrie alors qu'il n'avait aucun antécédent dans ce domaine.
Ses chances de retrouver un emploi ont été réduites par son état de santé, de même que par son âge : 57 ans au moment de son licenciement.
Son ancienneté au moment de son licenciement par ailleurs était importante : 9 ans d'ancienneté.
Présent en personne à l'audience, M. G. a indiqué avoir été profondément marqué et humilié par sa période de travail au sein de la Société Générale les dernières années, avec un état de santé toujours fragilisé par ce qu'il a subi.
Il a précisé s'occuper à présent de soins palliatifs à domicile en libéral après une année chez PROPARA en tant que médiateur familial.
Il s'évince de l'ensemble que le préjudice subi par M. G. et résultant de la perte de son emploi doit être évalué à hauteur de 35.000 euros nets.
-
Sur l'exécution provisoire
En l'espèce, le juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Montpellier a jugé que :
« Concernant l'exécution provisoire, selon la défenderesse, elle doit être écartée dès lors que M. G. n'offre pas de garantie de solvabilité et qu'en cas d'appel ses demandes pourraient être rejetées.
Cependant, retenir le seul risque d'insolvabilité future d'un salarié comme critère consisterait à rejeter par principe toute exécution provisoire car ce risque existe toujours, ce qui ne correspond pas à la volonté du législateur.
Rejeter toute exécution provisoire sur la seule base du risque d'insolvabilité d'un salarié serait aussi incorrect juridiquement que de motiver une exécution provisoire par le seul risque d'une liquidation judiciaire de l'entreprise employeur.
L'éventuel débiteur de l'obligation exécutoire par provision doit démontrer qu'au regard de sa situation financière et de ses facultés de paiement, ce risque aurait des conséquences manifestement excessives, ce qu'il ne fait pas au cas d'espèce.
La procédure instituée par le législateur en matière prud'homale, avec un préalable de conciliation, une audience de jugement en formation paritaire puis la possibilité d'une seconde audience de jugement en formation de départage présidée par un magistrat professionnel n'a pas une vocation dilatoire, ce qui explique l'instauration de délai très court entre la décision de partage de voix et de renvoi d'une part et l'audience paritaire d'autre part : 1 mois.
En l'espèce, ce délai est supérieur à deux ans.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme dans un arrêt Buchlotz cl Allemagne n° 7759/77 en date du 6 mai 1981 affirme qu'une rapidité particulière doit s'imposer dans le contentieux du travail, ce qu'elle a eu l'occasion de rappeler régulièrement dans des arrêts postérieurs notamment Delgado cl France n° 11/38437-97 en date du 14 novembre 2000, conformément aux dispositions de l' article 6 de la CESDH.
Il appartient aux juridictions nationales de faire respecter ces dispositions impératives supra-nationales.
En l'espèce, la saisine de la juridiction date du 5 novembre 2015, donc la procédure a déjà duré 4 ans et 3 mois.
Compte tenu de la charge de travail très importante de la Chambre sociale de la Cour d 'Appel de Montpellier donc des délais d'audiencement, au vu de la nature de l'affaire et de l'ancienneté des faits, sera ordonnée l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. »
Conseil de Prud'hommes de Montpellier, jugement de départage du 11 février 2020 RG N° F 15/01604
La Société Générale a déclaré appel de cette décision.
La Cour d'appel de Montpellier a confirmé la condamnation de la Société Générale pour harcèlement moral.
Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2022 N° RG 18/00269
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/
Image par Steve Buissinne de Pixabay